
Voici la vidéo de la présentation que j’ai donnée le 1er juillet dernier, à la Conférence de l’International Cultic Studies Association – organisée à distance depuis Montréal.
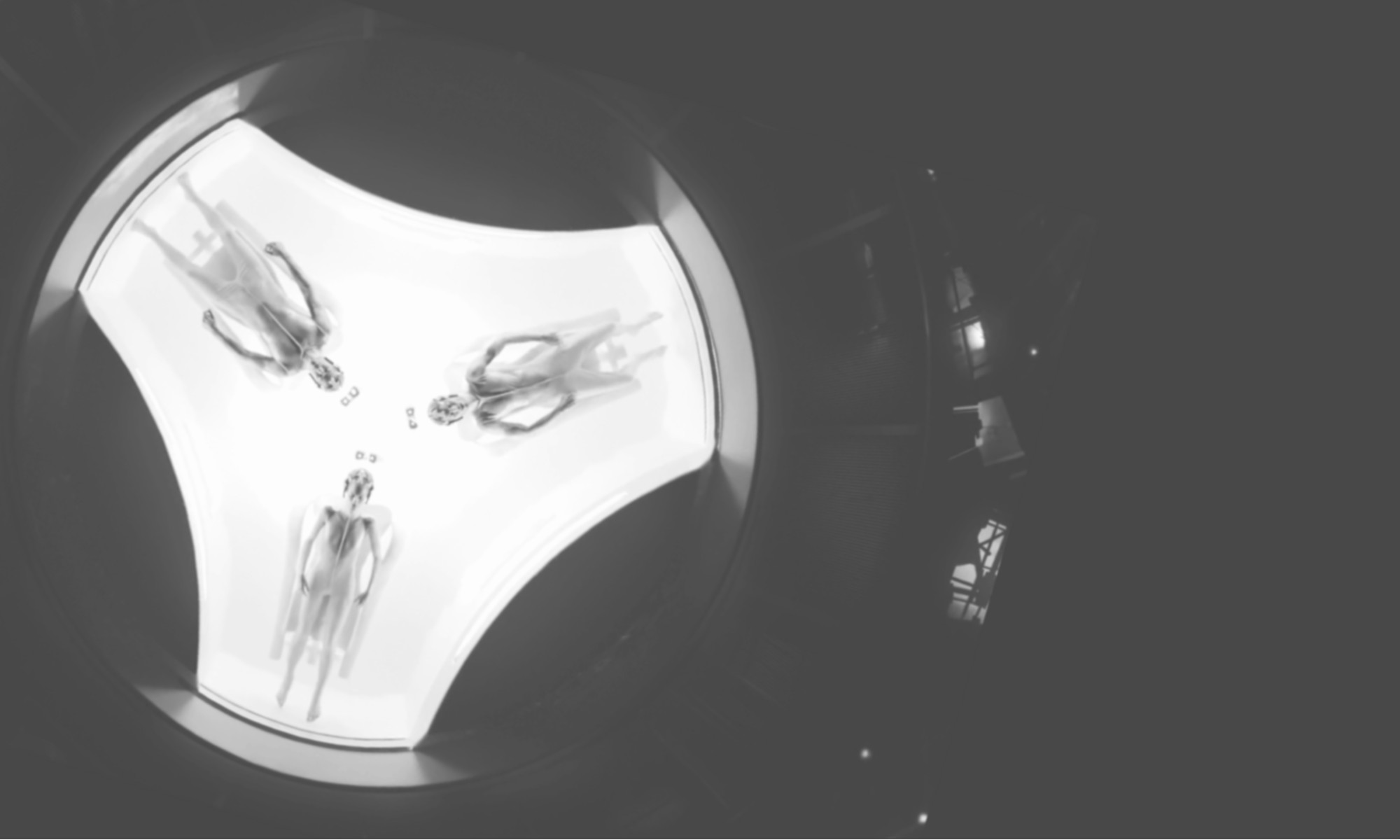
Analyses alternatives | Renseignement et sureté

Voici la vidéo de la présentation que j’ai donnée le 1er juillet dernier, à la Conférence de l’International Cultic Studies Association – organisée à distance depuis Montréal.

Le balado de Radio-Canada intitulé Dérives – le rituel de sudation est l’œuvre d’Olivier Bernard, bien connu au Québec pour ses ouvrages et émissions de vulgarisation scientifique. Sa nouvelle enquête en 8 épisodes, d’une durée totale de 5h30, nous replonge dans une affaire qui avait défrayé la chronique au Québec en 2012 : le décès de Chantal Lavigne, 35 ans, survenu suite à un rite de sudation, au cours d’un séminaire de développement personnel.
 Cette production audio d’Olivier Bernard est le fruit d’une recherche poussée et intelligente. Depuis que je vis au Québec (15 ans), c’est la première fois que je tombe sur un travail médiatique aussi sérieux consacré aux sectes dans la province.
Cette production audio d’Olivier Bernard est le fruit d’une recherche poussée et intelligente. Depuis que je vis au Québec (15 ans), c’est la première fois que je tombe sur un travail médiatique aussi sérieux consacré aux sectes dans la province.
Toute personne intéressée de près ou de loin par la question des sectes se doit d’écouter ce programme. La démarche de vulgarisateur scientifique d’Olivier Bernard l’amène à se poser des questions essentielles et à tenter d’y répondre honnêtement et en profondeur. L’auteur choisit l’approche du candide pour embarquer l’auditeur dans son cheminement réflexif. Et c’est très efficace.
Seul bémol : dans le 7e épisode, consacré à la question de l’encadrement des pratiques sectaires, notre candide se heurte à un écueil de taille qu’il n’avait pas vu venir.
Continuer la lecture de « Alain Bouchard, virtuose québécois du sophisme pro-sectaire »

Le 2 juin dernier, était déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale française une Proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne.
 Son auteure, la députée Laurence Vanceunebrock (LREM) était déjà la co-rapporteure en 2019 d’un mission d’information de l’Assemblée sur le même thème.
Son auteure, la députée Laurence Vanceunebrock (LREM) était déjà la co-rapporteure en 2019 d’un mission d’information de l’Assemblée sur le même thème.
Cette proposition de loi intéresse particulièrement les observateurs du phénomène sectaire, puisqu’un certain nombre de groupes religieux radicaux ont recours aux thérapies de conversion.
L’inquiétude dont se prévaut la députée est légitime. Et il ne fait guère de doute que cette proposition de loi sera entérinée par la représentation nationale. En effet, qui au Parlement pourrait cautionner de telles pratiques moyenâgeuses et refuser de voter ce texte ?
Et pourtant, la proposition pose problème ; non pas quant à la pertinence de son objectif, mais quant aux moyens qu’elle se propose d’utiliser, au nom de cet objectif.
Sommaire général ⇒ ⊕

La distinction entre le chiffrement réversible et le cryptage n’est pas une question de calcul cryptographique. Dans les deux cas, on a besoin d’une clé de chiffrement pour chiffrer l’information. La différence réside dans les modalités d’utilisation du chiffrement et dans le but recherché par le chiffreur.
Le chiffrement réversible présente un intérêt évident dans la vie de tous les jours. Il permet d’assurer la confidentialité d’une information, autrement dit de veiller à ce que cette information ne soit accessible qu’aux seules personnes autorisées à en prendre connaissance. Cela suppose que ces personnes autorisées puissent en prendre connaissance. On ne peut pas, en effet, communiquer de façon récurrente en utilisant du chiffrement irréversible : cela nécessiterait que les interlocuteurs (et eux seulement) soient capables de décrypter rapidement les messages qui leur sont adressés. Le chiffrement doit ici être réversible.
Toutefois, il existe des cas dans lesquels le chiffrement doit ne pas pouvoir être inversé. Continuer la lecture de « « Cryptage » n’est pas un gros mot – 4 ̷₄ »
Sommaire général ⇒ ⊕

Le mot cryptage produit sur les gardiens du dogme informatique le même effet qu’un crissement de craie sur un tableau noir. Leur réaction est immédiate et immuable : le cryptage, ça n’existe pas.
Et d’échafauder une dialectique reposant sur de bien faibles arguments lexicaux (3.1) et sur l’idée erronée selon laquelle le cryptage ne peut pas exister parce que l’on ne peut pas chiffrer sans clé (3.2).
À en croire les mollahs des DSI, cryptage n’est pas un mot de la langue française parce qu’il n’existe pas dans le dictionnaire de l’Académie française.

Continuer la lecture de « « Cryptage » n’est pas un gros mot – 3 ̷₄ »
Sommaire général ⇒ ⊕

Pour retrouver l’information en clair à partir de sa forme chiffrée, deux possibilités se présentent :
Notons que la langue française marque clairement la distinction fondamentale entre déchiffrement et décryptage. Il n’en va pas de même dans la langue anglaise, laquelle utilise :
– les verbes to encrypt , cipher et encipher pour traduire chiffrer (#–#),
– les verbes to decrypt et to decipher pour traduire indistinctement (ou respectivement !) déchiffrer et décrypter (#–#).
Continuer la lecture de « « Cryptage » n’est pas un gros mot – 2 ̷₄ »
Sommaire de cette série :
 Le mot cryptage n’est pas un barbarisme. Il ne désigne pas non plus un impossible chiffrement sans clé. Le cryptage, c’est du chiffrement, mais dans certaines circonstances. La distinction présente un intérêt dans le domaine du renseignement et des enquêtes informatiques.
Le mot cryptage n’est pas un barbarisme. Il ne désigne pas non plus un impossible chiffrement sans clé. Le cryptage, c’est du chiffrement, mais dans certaines circonstances. La distinction présente un intérêt dans le domaine du renseignement et des enquêtes informatiques.
Il y a quelques semaines, j’ai eu sur Twitter une discussion (i.e. un dialogue de sourds) avec un professionnel de l’informatique au sujet du mot cryptage. Véritable tarte à la crème de la sécurité de l’information, le débat sur ce mot n’en finit pas de noircir des pages. Pour résumer grossièrement, dans cette bataille rangée, deux camps s’opposent :
Le cryptage n’existe pas. c’est tout. point. merci au revoir bonne soirée.
— OnDit Chiffrer (@OnDitChiffrer) 14 mars 2019

Le modèle de la bergerie se propose, sur une base objective :
de détecter les églises délinquantes ;
et, parmi elles, de distinguer entre les églises radicales et les églises malveillantes.
Pour en faire la démonstration, nous prendrons ici comme exemples deux nouveaux mouvements religieux particulièrement controversés : les Témoins de Jéhovah (4.1) et l’Église de scientologie (4.2).
Continuer la lecture de « Sectes – L’allégorie du berger revue et corrigée – 4. ̷₄ »

On rencontre traditionnellement deux acceptions concurrentes du mot « secte » :
Mais quels sont les critères objectifs et pertinents qui permettent de faire la distinction entre les deux acceptions ?
Continuer la lecture de « Sectes – L’allégorie du berger revue et corrigée – 3. ̷₄ »
Quand au mouton bêlant la sombre boucherie
Ouvre ses cavernes de mort,
Pâtres, chiens et moutons, toute la bergerie
Ne s’informe plus de son sort. (…)
André Chénier, Ïambes

Voilà des décennies que l’on représente le rapport entre un gourou et ses adeptes par l’allégorie du berger. Au-delà du lieu commun, cette représentation simpliste présente trois défauts majeurs :
Il s’avère donc essentiel de modifier le modèle du berger afin qu’il puisse donner une vision plus nuancée des organisations religieuses et mieux rendre compte de leur éventuel degré de dangerosité.
Continuer la lecture de « Sectes – L’allégorie du berger revue et corrigée – 2. ̷₄ »