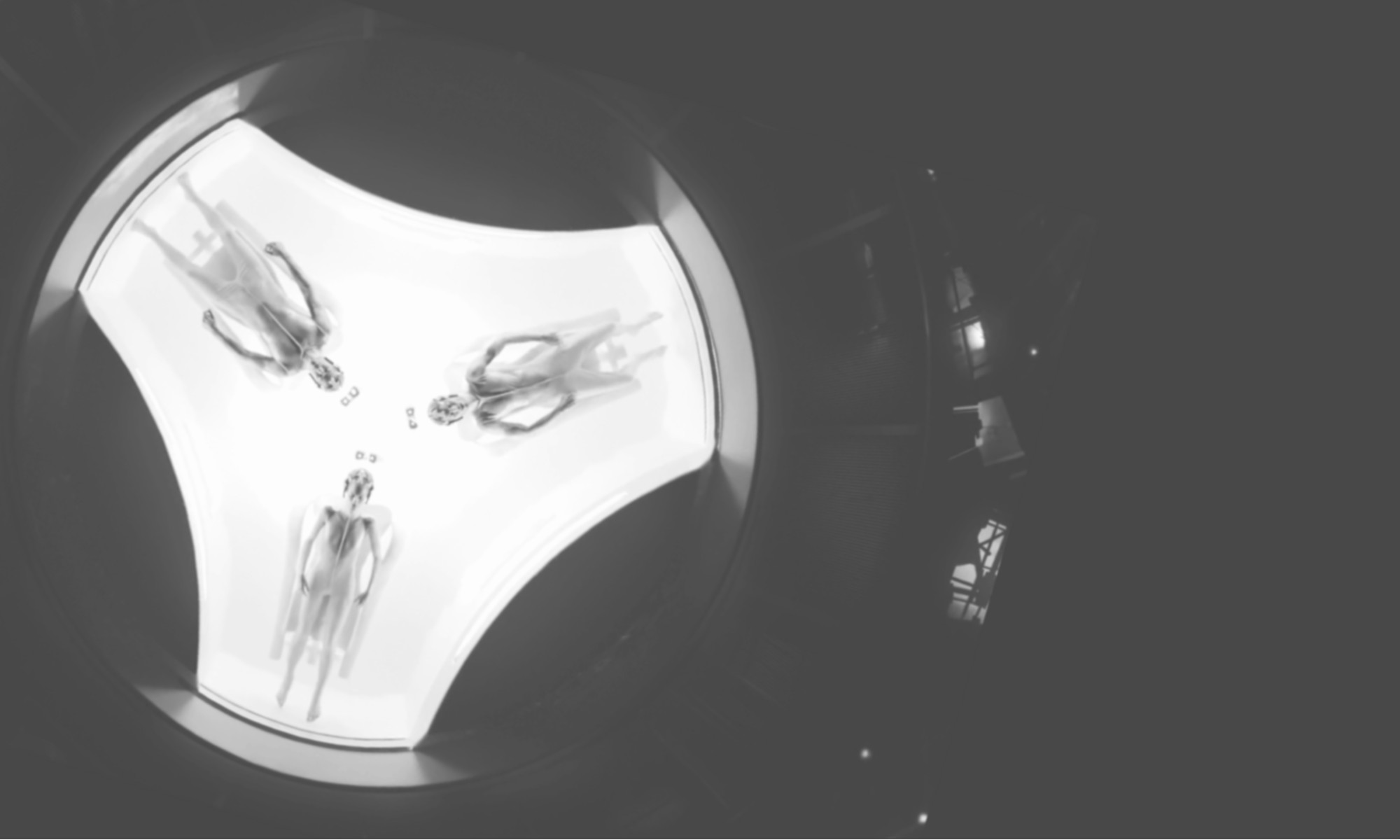La lutte contre les dérives sectaires ne doit pas se concentrer sur la notion d’emprise mentale de la victime. Il convient au contraire de focaliser sur les actes matériels et la volonté infractionnelle du délinquant.
Mme Sonia Backès est depuis quelques mois la Secrétaire d’État chargée de la citoyenneté. À ce titre, elle chapeaute la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). Elle en est rapidement devenue le visage médiatique (et très médiatisé) – éclipsant du même coup Christian Gravel et Hanène Romdhane, respectivement président et cheffe de ladite mission.
Dans une entrevue au journal Marianne parue le 3 novembre dernier, évoquant les objectifs de la Miviludes sous sa gouverne, Sonia Backès proclamait que, pour lutter efficacement contre les «dérives sectaires», il faudra intégrer la notion d’emprise mentale dans l’arsenal législatif.

Bien sûr ! s’exclamera-t-on de prime abord. On ne peut pas être contre la vertu.
Et pourtant, c’est une très mauvaise idée. En voici l’explication, en 3 étapes.
1. La lutte contre les sectes, c’est d’abord l’affaire du droit pénal.
Il ressort des déclarations de Sonia Backès que l’intégration de l’emprise mentale dans l’arsenal législatif vise à lutter contre les dérives sectaires.
Or, la lutte contre les dérives sectaires, ce n’est pas la même chose que l’aide aux victimes de dérives sectaires. Les deux activités sont complémentaires, mais il est important de ne pas les confondre. En effet, la première relève principalement du droit pénal, tandis que la seconde intéresse le droit civil.
La différence de nature entre le droit civil et le droit pénal est la suivante :
- le droit civil régit les relations entre les personnes. Il s’assure notamment qu’un dommage causé à une personne soit réparé. Le droit civil est donc axé sur la victime.
- le droit pénal incrimine et sanctionne les comportements qui portent atteinte à l’organisation de la vie sociale et aux valeurs essentielles de la société. Il se polarise sur le délinquant.
Focaliser l’action pénale sur la notion d’emprise mentale est selon moi une erreur. Car la réponse répressive serait alors conditionnée à la situation de la victime (droit civil) et non à l’action du délinquant (droit pénal).
2. Ce n’est pas la victime qui fait l’infraction pénale.
Un comportement nuisible à la société peut ne pas causer de préjudice à une personne. En droit pénal, il n’est donc nullement impératif qu’il y ait victime pour que des infractions soient constituées.
Pour plus de détails sur ce point précis, je vous renvoie à cet article de mon blogue.
Prenons un exemple. L’escroquerie n’est pas le fait pour une victime d’être escroquée. C’est le fait pour un individu d’escroquer sa victime.
On pourrait rétorquer : « Mais enfin, c’est la même chose, vous jouez sur les mots !»
Mais non. Ce qui est puni par la loi pénale, c’est bien l’acte matériel de l’escroc, accompagné de sa volonté de tromper sa victime.
C’est pour cela qu’il est possible de punir l’escroc même s’il rate son coup et que sa cible ne mord pas à l’hameçon. Il n’y a alors pas de victime. Mais il y a quand même (tentative d’) escroquerie, donc infraction pénale.
3. Ce n’est pas la victime qui fait le délinquant.
Focaliser sur l’emprise mentale, c’est se concentrer non pas sur l’intention du délinquant, mais c’est tenter de rentrer dans la tête de la victime. Donc, si l’on devait introduire l’emprise mentale dans l’arsenal répressif, pour déterminer s’il y a infraction pénale, au lieu de s’intéresser aux actes du délinquant, on essaierait d’établir ce que la victime pensait lorsqu’elle s’est fait manipuler.
Résultat des courses : ce qui déterminerait la culpabilité du délinquant, ce ne serait ni la nature de ses actes, ni son intention coupable. Non, ce qui déciderait de l’issue du procès pénal, ce serait une expertise psychologique ou psychiatrique de la victime. Ce qui va bien sûr de pair avec une grosse subjectivité et des batailles d’experts.
On objectera : « On fait déjà appel à des experts psy dans certains procès pénaux.»
C’est vrai. Mais ce sont des cas rares, où la question du consentement est centrale. Hors de ces situations, il n’est nul besoin de faire reposer la culpabilité du délinquant sur la psychologie de la victime.
Par exemple, le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Lorsqu’une personne se fait voler un bien, on pourrait dire : « il faudrait savoir si la personne qui s’est fait voler avait conscience de se faire déposséder.» Dans certains cas (très rares), l’idée pourrait être pertinente. Mais ce qui va caractériser le vol, c’est bien le fait pour un voleur de soustraire frauduleusement le bien d’autrui.
Ainsi, si le voleur ignore que la victime avait décidé de se défaire du bien volé mais que le bien lui appartenait toujours ; le voleur l’aura toutefois soustrait frauduleusement. C’est donc un vol.
De la même façon, pour l’immense majorité des crimes et des délits, il est légitime de déterminer la culpabilité du délinquant SANS avoir à regarder dans la tête de la victime.
La Miviludes roule pourtant à contre-sens depuis 20 ans, en focalisant l’action des pouvoirs publics sur l’abus de sujétion psychologique de l’article 223-15-2 du Code pénal. Et ce, au détriment d’autres textes pénaux autrement plus adaptés – et plus sévères.
Pour plus de détails sur ce point, je vous renvoie
à ma thèse de doctorat, p. 287 à 293.
Dans le domaine des « dérives sectaires », focaliser l’approche pénale sur la notion d’emprise mentale reviendrait donc à perpétuer une erreur stratégique majeure.
Related Posts
À propos de Arnaud Palisson
Arnaud Palisson, Ph.D. fut pendant plus de 10 ans officier de police et analyste du renseignement au Ministère de l'intérieur, à Paris (France). Installé à Montréal (Canada) depuis 2005, il y a travaillé dans le renseignement policier puis en sureté de l'aviation civile. Il se spécialise aujourd'hui dans la sécurité de l'information et la protection des renseignements personnels.